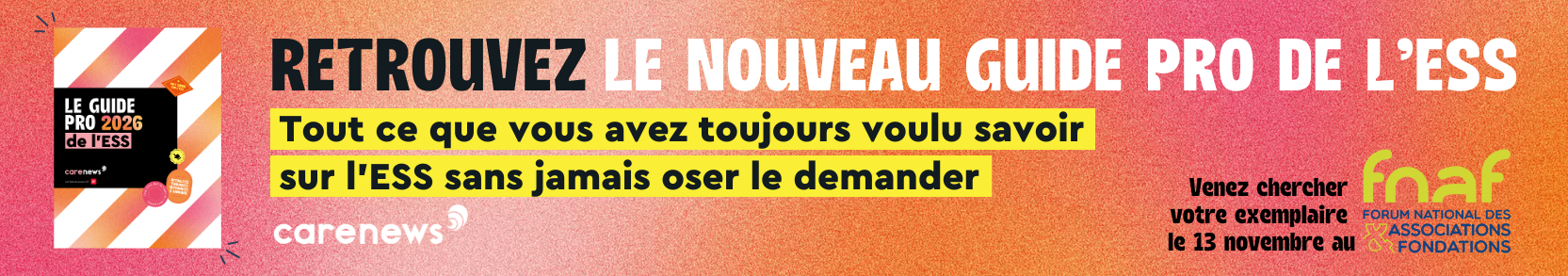Les femmes d’outre-mer en première ligne pour construire un monde durable
Gardiennes de savoirs ancestraux, les femmes autochtones portent en elles des réponses concrètes aux défis écologiques d’aujourd’hui. À travers l’association En Terre indigène, la directrice de projets Anne Pastor met en lumière leurs voix, leurs pratiques et leur rôle ancestraux pour le progrès de la société. Un projet soutenu par la Fondation groupe EDF. Il a pour objectif de promouvoir des savoirs écologiques sur 4 territoires ultramarins : Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion. 5 savoirs écologiques sur la gestion des ressources naturelles à destination des femmes vulnérables sous forme d’ateliers de transmission organisés avec la collaboration des associations locales partenaires.

-
Parlez-nous de l’association En Terre indigène.
Au départ, je suis documentariste pour France Inter et France Culture, et je porte la voix des peuples autochtones depuis plus de vingt ans, en particulier celle des femmes. Au total j’ai réalisé près de 100 documentaires. En 2018, j’ai créé la Voix des Femmes autochtones, une plateforme documentaire où j’ai réalisé 40 portraits dans 16 pays. Un projet soutenu par la Fondation Chanel pour mettre en lumière ces femmes dont les actions sont un véritable laboratoire d’idées pour demain.
À l’issue de ce projet, j’ai travaillé sur nouveau projet, autour de trois mots-clés : femmes, écologie et outre-mer. Les femmes autochtones nous avaient alors exprimé leur inquiétude concernant la transmission de leurs savoirs. Même si ces savoirs sont préservés ils risquent de se perdre car la transmission est parfois difficile. C’est pourquoi j’ai lancé le projet « De la mère à la terre », qui accompagne aujourd’hui treize, bientôt quatorze femmes de savoir en Outre-mer. Je pense en particulier aux femmes de savoirs à la Caraïbe, où par exemple le chlordécone a totalement pollué les sols. Là-bas, les prix des denrées alimentaires sont 50 à 60 % plus élevés qu’en métropole, et 80 % des produits sont importés. Les femmes sont doublement victimes.
Mais ces femmes, notamment dans la Caraïbe, puisent dans les traditions et pratiques agricoles anciennes, souvent issues de la période de l’esclavage, pour proposer des modèles d’agroécologie, de souveraineté alimentaire et de sobriété heureuse.
D’ailleurs, on ne dit pas « pratiquer l’agriculture », on dit « cultiver la terre »,, en connexion avec la nature.
-
L’association travaille particulièrement avec les femmes et les jeunes filles. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les difficultés propres aux femmes, notamment en Outre-mer ?
Dans la Caraïbe, la situation est particulièrement difficile. Les dernières études montrent que plus de 60 % des familles sont monoparentales, c’est-à-dire que ce sont des femmes qui élèvent seules leurs enfants. Elles portent donc la responsabilité de l’éducation, de la culture et des ressources du foyer. Une étude récente du Programme alimentaire des Caraïbes montre que 3 millions de personnes, soit plus de 30 % de la population, ne mangent pas à leur faim, principalement à cause du coût de la vie. Les femmes sont aussi beaucoup plus touchées par le chômage, plus de 50 % d’entre elles n’ont pas d’emploi.
C’est en ce sens que je dis qu’elles sont doublement victimes : à la fois économiquement et socialement.
Et si on prend des chiffres plus généraux, pas seulement liés à l’Outre-mer, ONU Femmes rappelle qu’une femme sur trois dans le monde sera victime de violences sexuelles au cours de sa vie. Elles sont donc doublement discriminées, et encore plus quand elles sont autochtones.
-
Pourquoi ces savoirs risquent de se perdre. Est-ce que les jeunes générations s’y intéressent moins ? Est-ce qu’ils ne sont plus transmis ?
C’est un risque, oui, parce qu’on vit aujourd’hui dans un monde globalisé, avec une uniformisation de la pensée et de la culture. Comme dans beaucoup d’autres sociétés, il y a eu un moment où la transmission intergénérationnelle ne s’est plus faite automatiquement. Certains de ces savoirs se sont donc affaiblis, Pas tous, heureusement.
Mais à la différence de certains savoirs occidentaux qui ont totalement disparu, ceux-là existent encore, dans la mémoire collective. Il suffit de les réveiller.
Et au-delà de la transmission, ces savoirs issus de la nature sont aujourd’hui une réponse directe à la crise environnementale et aux enjeux contemporains.
-
En septembre dernier ont eu lieu les Rencontres du patrimoine ultramarin, dont l’objectif était de partager et de construire ensemble un monde plus durable. Donnez-nous quelques exemples.
Quand les femmes autochtones disent, dès la COP 22, « Nous sommes la solution », elles ont raison : elles sont la solution. Les peuples autochtones, et les femmes en particulier, sont en première ligne. Pour prendre un exemple : Le jardin créole, un jardin tout à la fois pharmacie, garde-manger et réserve de la biodiversité. C’est un modèle d’agroécologie, de souveraineté alimentaire et de sobriété heureuse. Il est né pendant la période esclavagiste en Guadeloupe, et c’est aujourd’hui un modèle dont on pourrait largement s’inspirer car il est un modèle d’agroécologie, de sobriété heureuse et d’autonomie alimentaire
Tous ces savoirs s’inscrivent dans cet esprit, celui d’une écologie ancrée, solidaire, plus démocratique et plus émancipatrice. Bref, d’une écologie durable.
Un autre exemple, toujours en Martinique : Monette Marie-Louise s’inspire du modèle Songhaï au Bénin, une forme d’agriculture autonome. Elle invite les femmes à reprendre leur place dans la société, notamment dans l’agriculture, en travaillant à partir de produits locaux et en cherchant à limiter la dépendance aux importations. Elle parle aussi d’« agriculture de risque », car de nombreux territoires insulaires — en Indonésie, dans le Pacifique ou dans la Caraïbe — sont aujourd’hui confrontés à des aléas climatiques et à d’autres catastrophes naturelles : volcans, montée des eaux, etc.
Pratiquer cette agriculture autonome, c’est apprendre aux gens à se nourrir et à se soigner avec ce qu’ils ont sur place, à partir des graines locales qu’ils replantent eux-mêmes.
À La Réunion, on travaille sur une autre thématique : la médecine par les plantes. Mais au-delà de cette pratique, il s’agit de la reconnaissance de cette médecine traditionnelle, qui trouve aujourd’hui toute sa place dans ce qu’on appelle la médecine intégrative, c’est-à-dire une médecine qui cohabite avec la médecine allopathique classique.
Par exemple, lors de la forte épidémie de chikungunya cette année à La Réunion, quand vous alliez à la pharmacie, on vous proposait du Doliprane pour les maux de tête, mais dans le même temps, de nombreuses plantes pouvaient aider à en atténuer les effets.
-
Quel ont les événements à venir pour En terre indigène ?
Nous allons bientôt présenter le projet à la COP de Belém du 10 au 21 novembre sur la caravane des chercheurs de l’IRD Iracu, au stand de la collectivité de Guyane et à l’Alliance Française de Belém et de Cayenne. Ces femmes sont de véritables modèles d’inspiration pour tout le monde.
-
Pour terminer, comment un salarié du groupe EDF peut-il s’engager à vos côtés ?
Puisque nous sommes soutenus par les entités locales du groupe EDF — Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion — le plus simple, c’est de se rapprocher directement des associations sur le terrain. Chacune des femmes que nous accompagnons porte une structure locale.
Les salariés peuvent donc relayer leur parole, parler non seulement d’En Terre indigène, mais aussi de leurs projets.
Ce sont des femmes très accessibles, et ce soutien humain et collectif est précieux.