François Bayrou rassure les associations sur les déductions fiscales liées aux dons
Un rapport d’inspection rendu au gouvernement comporte des propositions pour limiter les déductions d’impôts auxquelles ouvrent droit les dons. Cette révélation du Parisien a suscité une levée de bouclier parmi les associations. Interrogé, François Bayrou a assuré qu'il n'y aurait pas de remise en cause du cadre fiscal lié à la générosité. Cela concerne aussi bien les associations reconnues d'utilité publique que les autres.
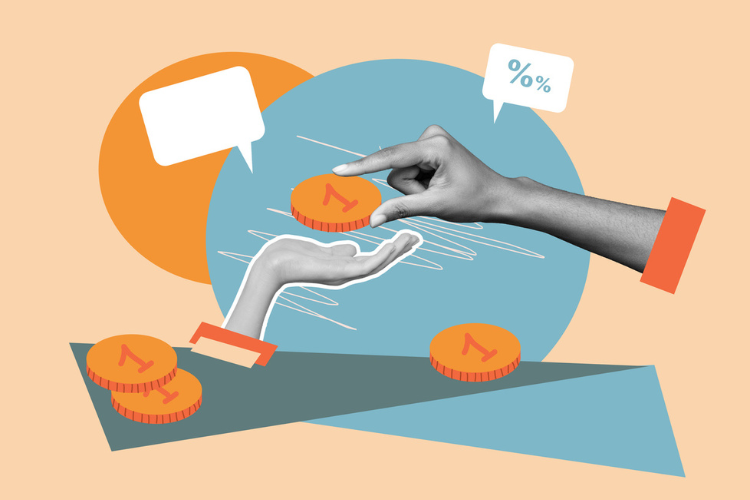
Des propositions pour réduire les dépenses publiques en faveur des associations ont été formulées, selon Le Parisien, par l’Inspection générale des finances (IGF) et l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) dans un rapport non publié remis au gouvernement en mai. Plusieurs d’entre elles visent à limiter les déductions d’impôts auxquelles ouvrent droit les dons, « outre diverses coupes franches dans les subventions directes », peut-on lire dans Les Echos, qui disent également avoir eu accès au rapport.
De quoi inquiéter largement les associations et les fondations dans le cadre de l'élaboration du budget de l'État pour 2026 : leurs ressources dépendent au moins en partie des dons du public. La Coalition générosité, qui fédère divers acteurs de la générosité, dont Admical, le CFF, France générosités et le Mouvement associatif, s'est fortement mobilisé. « Nous avons multiplié, au cours des 15 derniers jours, les rencontres avec les cabinets (...) afin de les alerter, de plaider pour la stabilité des dispositifs », ont témoigné Marion Lelouvier et Benjamin Blavier, la présidente et le délégué général du Centre français des fonds et des fondations (CFF) dans un communiqué rendu public le 4 juillet, le jour de la publication de l'article du Parisien. « Nous nous sommes concentrés sur la mobilisation des réseaux d'entreprises, sensibles à la préservation de ce levier d'engagement sociétal », indique Yann Queinnec, délégué général d'Admical.
La mobilisation semble avoir payé. « Les associations de lutte contre la pauvreté, qui sont toutes des associations reconnues d'utilité publique, et les associations reconnues d'utilité publique ne seront en aucun cas touchées par des mesures de reconfiguration », a assuré le Premier ministre François Bayrou, interrogé à ce sujet le 8 juillet. Cette reconnaissance d’utilité publique est délivrée à certaines associations par décret en Conseil d’État et sur rapport du ministère de l’Intérieur. Néanmoins, la plupart des associations dites d’intérêt général ne bénéficient pas de la reconnaissance d'utilité publique, qui obéit à des conditions très strictes et exige des démarches spécifiques.
« Le cabinet du Premier ministre nous a confirmé que le projet de loi de finances pour 2026 ne contiendra aucune mesure remettant en cause la fiscalité de la générosité : ni celles évoquées dans le rapport IGF-IGESR, ni d'autres », s'est réjoui le syndicat France générosités dans un post publié sur le réseau social LinkedIn. Le gouvernement ne proposera pas d'évolution du cadre fiscal lié à la générosité, ni pour les associations reconnues d'utilité publique, ni pour les autres, comme nous le précise France générosités.
À lire aussi : L'ANTISÈCHE - Au fait, c'est quoi la différence entre intérêt général et utilité publique ? 
Une diminution des dons de 1,1 à 1,5 milliard d’euros
« Restons vigilants : l'intention est là, mais nous attendons la preuve dans le texte du budget », a souligné le CFF sur le même réseau, confirmant par la même occasion l'information de France générosités.
Dans le détail, l'IGF et l’IGESR proposaient de limiter à 2 000 euros la réduction d’impôt sur le revenu de 66 % du montant des dons effectués par le contribuable, alors qu’elle peut aller jusqu’à 20 % des revenus à ce jour. Cela rapporterait 360 millions d’euros aux finances publiques, selon Le Parisien et Les Echos.
Les auteurs suggéraient aussi de supprimer le dispositif spécial pour les dons aux associations venant en aide aux personnes en difficulté, ouvrant droit à une réduction d’impôt de 75 % du montant des dons dans une limite de 1 000 euros. Ils tablaient cette fois-ci sur une économie de 47 millions d’euros.
De plus, l'IGF et l'IGESR envisageaient de faire passer le taux de réduction d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) de 75 % à 50 %, dans une limite de 20 000 euros de dons contre 50 000 euros à ce jour, pour un gain de 48 millions d’euros. Enfin, le mécénat d’entreprise « passerait d'une réduction d'impôt de 60 % à un régime de déductibilité des dons du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés », ont précisé Les Echos, pour une économie de 523 millions d’euros.
Plus de six milliards d'euros de dons déclarés
Ces propositions « auraient pour conséquence de diminuer dans une fourchette de 1,1 à 1,5 milliard le montant des dons des particuliers et des entreprises aux associations et fondations (...). Ce qui amputerait considérablement leurs actions au service de nos concitoyens », a affirmé la Coalition générosité. « La Coalition Générosité exprime donc fermement son opposition [à ces] recommandations », ont écrit ces organismes dans un communiqué le 4 juillet. 3,6 millions d'euros de dons ont été déclarés par les particuliers au titre de l'impôt sur le revenu et de l'IFI en 2022, ainsi que 2,7 milliards d'euros par les entreprises au titre de l'impôt sur les sociétés, selon France générosité.
Selon Admical, association spécialisée sur le mécénat d’entreprise, « 97 % des entreprises mécènes sont des TPE/PME [petites entreprises] dont 88 % soutiennent des projets locaux et régionaux ». Le dispositif de déduction fiscale à destination des entreprises « n'est donc pas une stratégie d’optimisation mais un acte de conviction au service des territoires ».
Un palliatif pour le « sous-investissement » de l’État
La réduction du plafond de la réduction d’impôts pour les dons des particuliers « entraînerait une baisse d’environ 25 % de la collecte », ont déploré douze associations et fondations de recherche biomédicale, comme l’AFM Téléthon, la Fondation pour la recherche sur le cancer ou l’Institut Pasteur, dans un communiqué commun. La proposition sur le mécénat d’entreprise pourrait selon elles réduire la collecte issue des dons des entreprises de 17 % à 24 %.
« Cette menace est d’autant plus préoccupante que les structures privées de recherche biomédicale dépendent aujourd’hui en grande partie de la générosité du public », ont-elles souligné. La quasi-totalité des ressources de la Fondation pour la recherche médicale (FRM), par exemple, ou 35 % des financements du centre de recherche de l’Institut Curie dépendent de la générosité du public.
Ces ressources financent « les salaires des chercheuses et des chercheurs, le fonctionnement de leurs laboratoires, les équipements qu’ils utilisent, les programmes de recherche auxquels ils travaillent (...), palliant le sous-investissement de l’État dans la recherche », ont illustré les organisations. Elles ont qualifié la réduction fiscale liée aux dons comme d’un « véritable levier de financement ».
Les organisations de solidarité appellent à d’autres économies
Le Collectif Alerte, réunissant des associations et fédérations de lutte contre la pauvreté, a qualifié ces propositions de « particulièrement dramatiques pour des structures déjà fortement fragilisées et confrontées à des besoins sociaux en augmentation ».
Les 37 organisations membres, dont Action contre la faim ou la Fondation pour le logement, appellent plutôt à une « remise à plat des dépenses inefficaces ou injustes », comme les « niches fiscales », les « exonérations patronales mal ciblées » ou les « subventions nuisibles à l’environnement », ainsi qu’à une « réforme en profondeur de notre fiscalité pour plus de justice et de solidarité » pour répondre aux impératifs budgétaires.
Des organisations contraintes de « mettre la clé sous la porte » ?
« Couper dans les dispositifs de réduction fiscale, c’est priver les associations de ressources vitales, décourager les citoyens de s’engager, affaiblir des actions concrètes au service du climat, du lien social, de l’éducation, de la culture et de la solidarité », a pour sa part affirmé Cédric Javanaud, le directeur général de la Fondation Goodplanet, dans un post diffusé sur le réseau social LinkedIn.
« Tuez les associations directement », a de son côté asséné Benoît Hamon, le président de la chambre représentative de l’économie sociale et solidaire, ESS France, dans un post publié sur le même réseau. « Dites surtout aux Français que le sport amateur, les établissements culturels, les ressourceries, recycleries, banque alimentaires, épiceries solidaires, crèches associatives, Ehpad associatifs vont mettre la clé sous la porte », a-t-il fustigé.
Célia Szymczak 

